Oui, mais la radicalisation de ce phénomène se radicalise et est actuellement stimulée par des personnes extrêmement riches qui combinent pouvoir politique et économique de façon inédite, comme nous le verrons dans un article sur le Crack-up Capitalism, concept forgé par le philosophe canadien Quinn Slobodian.
Le terme « ennemisation » a été popularisé en France par Christian Laval, notamment dans son livre Le choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (2023). Il y décrit comment la politique contemporaine est dominée par une logique d’hostilité et de polarisation, où les adversaires politiques sont transformés en ennemis à abattre plutôt qu’en interlocuteurs avec qui débattre.
Cependant, l’idée que la politique peut être structurée par une opposition manichéenne entre un « nous » et un « eux » n’est pas nouvelle. On retrouve des concepts similaires dans :
🔹 Carl Schmitt (La notion de politique, 1932) : il définit la politique par la distinction ami/ennemi, où le conflit est perçu comme constitutif du politique.
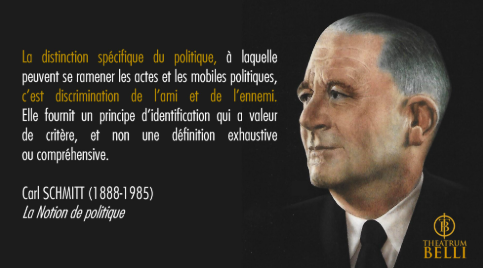
🔹 Chantal Mouffe (Le paradoxe démocratique, 2000) : elle parle d’antagonisme politique, expliquant que la démocratie repose sur une tension entre adversaires, mais que cette tension ne doit pas devenir destructrice.
🔹 Hannah Arendt (Les origines du totalitarisme, 1951) : elle analyse comment les régimes autoritaires créent des ennemis internes pour justifier leur pouvoir.
🔹 Pierre-André Taguieff (La nouvelle propagande antiraciste, 1993) : il évoque la construction d’ennemis symboliques dans les discours politiques et médiatiques.
Ainsi, Christian Laval n’a pas inventé l’idée d’ennemisation, mais il en a formulé une version contemporaine, liée à la montée du néolibéralisme et à la crise démocratique actuelle.
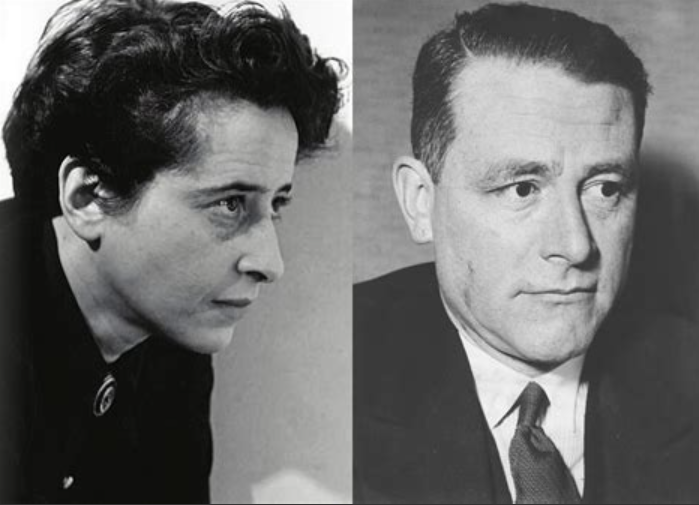
(Photo : Hannah Arendt et Carl Schmitt, deux conceptions très différentes du politique)
Hier et aujourd’hui
L’ennemisation d’aujourd’hui diffère de celle d’hier sur plusieurs aspects, notamment en raison des transformations politiques, économiques, technologiques et médiatiques. Voici les principales différences :
(1) Une diffusion accélérée par le numérique et les réseaux sociaux
🔹 Hier : L’ennemisation se construisait principalement à travers des discours politiques, des médias traditionnels (presse, radio, télévision) et des idéologies structurées. La construction de l’ennemi nécessitait du temps et une diffusion hiérarchisée.
🔹 Aujourd’hui : Avec les réseaux sociaux, les algorithmes favorisent la polarisation et les contenus émotionnels ou clivants. La logique du buzz et de la viralité renforce la fabrication d’ennemis en quelques heures, voire minutes.
👉 Exemple : Un discours hostile prononcé par un leader politique peut être amplifié instantanément sur X (Twitter), TikTok ou Facebook, générant des réactions en chaîne et intensifiant la polarisation.
(2) Une fragmentation du paysage politique et idéologique
🔹 Hier : L’ennemisation était souvent structurée autour de grands blocs idéologiques (guerre froide : capitalisme vs. communisme, droite vs. gauche). Les conflits étaient certes violents, mais souvent cadrés par des structures institutionnelles fortes.
🔹 Aujourd’hui : La montée des populismes, des extrêmes et des nouvelles fractures culturelles (woke vs. anti-woke, mondialistes vs. souverainistes, etc.) a fragmenté le paysage politique, rendant l’ennemisation plus diffuse et instable.
👉 Exemple : Au lieu d’un affrontement bipolaire comme pendant la Guerre froide, nous avons aujourd’hui des multiples lignes de fracture (géopolitiques, culturelles, économiques) qui s’entrelacent et s’intensifient.
(3) Une instrumentalisation accrue pour le pouvoir et l’économie
🔹 Hier : L’ennemisation était souvent liée à des enjeux géopolitiques et militaires (guerres, impérialisme, colonialisme). Elle servait à mobiliser les populations dans des cadres bien définis (ennemi intérieur ou extérieur).
🔹 Aujourd’hui : Elle devient un outil de gestion politique permanent, utilisé par certains dirigeants pour détourner l’attention des vrais problèmes (inégalités, crise climatique) et maintenir leur pouvoir. Elle est aussi exploitée à des fins économiques, notamment dans le marketing et l’industrie médiatique, qui capitalisent sur les conflits.
👉 Exemple : Les médias polarisants, comme Fox News aux États-Unis ou CNews en France, fonctionnent sur un modèle où l’ennemi est une ressource économique permettant de fidéliser un public et générer du profit.
(4) Une logique de guerre culturelle et identitaire plus marquée
🔹 Hier : L’ennemisation était souvent ancrée dans des luttes de classes, des rivalités économiques ou des conflits géopolitiques.
🔹 Aujourd’hui : Elle se focalise davantage sur des enjeux culturels et identitaires, où des groupes sont construits comme des menaces pour une supposée cohésion nationale ou civilisationnelle.
👉 Exemple : La montée des termes comme « woke », « éco-terroriste », « islamo-gauchiste », « grand remplacement », qui servent à désigner des groupes comme des ennemis menaçant un « nous » fantasmé.
(5) Une banalisation du discours violent et complotiste
🔹 Hier : L’hostilité politique et médiatique était souvent régulée par des institutions fortes (partis, médias contrôlés, diplomatie). La propagande restait cadrée et issue de sources de pouvoir identifiables.
🔹 Aujourd’hui : Avec la multiplication des sources d’information et la défiance envers les élites, les discours d’ennemisation sont plus sauvages et incontrôlés, alimentés par les théories du complot, les influenceurs radicaux et les bulles informationnelles.
👉 Exemple : Les attaques contre les élites, les « médias corrompus » ou la « dictature sanitaire » pendant la pandémie, qui ont contribué à fracturer encore plus les sociétés.
Conclusion : une ennemisation plus rapide, diffuse et permanente
✅ Ce qui reste : La logique de désignation d’un ennemi comme moyen de rassembler un groupe et de justifier certaines politiques.
🚀 Ce qui change : La vitesse de propagation, l’absence de régulation, la diversification des cibles et la place centrale des nouvelles technologies et des guerres culturelles.
L’ennemisation d’aujourd’hui est donc plus pernicieuse, car elle est devenue un outil du quotidien, utilisé non seulement par les politiques, mais aussi par les médias, les entreprises et les individus eux-mêmes. Pour en sortir, il faut renforcer l’éducation critique, favoriser des espaces de dialogue et réguler les plateformes qui amplifient ces dynamiques.
